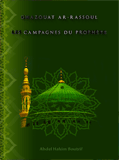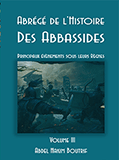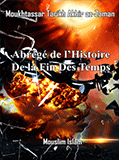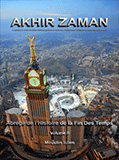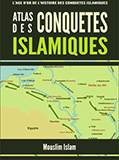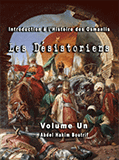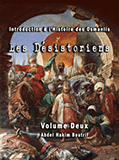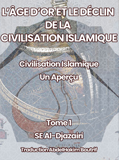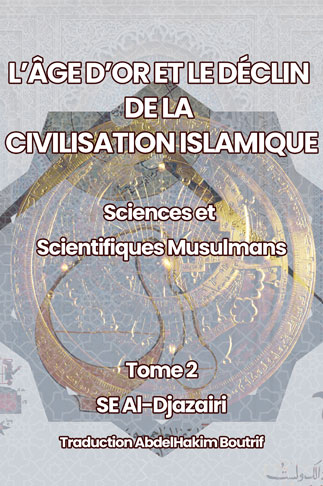Sciences et Scientifiques Musulmans
ASTRONOMIE ET OBSERVATION
Écrivant sur l’histoire de l’astronomie, Rybka ne manque pas de faire la remarque habituelle à quel point on accorde peu d’attention au rôle musulman dans le progrès de la science. Pannekoek, par exemple, ne consacre que sept pages à ce sujet. Il faut dire ici que Rybka est un peu malveillant envers Pannekoek, qui lui a consacré au moins sept pages, car d’autres, dans leur grande majorité, ne consacrent même pas une ligne à l’astronomie musulmane. Rybka souligne l’affirmation généralisée trouvée dans la plupart des ouvrages, à savoir que le rôle des astronomes musulmans était simplement de transmettre ce qui était trouvé dans l’Almageste de Ptolémée. Duhem, par exemple, affirme :
« Les révélations de la pensée grecque sur la nature du monde extérieur se sont terminées avec l’Almageste (de Ptolémée) paru vers 145 après JC, et a alors commencé le déclin du savoir antique. Celles de ses œuvres qui échappèrent aux incendies allumés par les guerriers musulmans furent soumises aux interprétations stériles des commentateurs musulmans et, comme une semence desséchée, attendirent le moment où le Christianisme latin leur fournirait un terrain favorable où elles pourraient à nouveau s’épanouir et porter du fruit. »
Un avis partagé par Perroy :
« Tous ou presque tous (les astronomes musulmans), suivent la pratique du plagiat du Moyen Âge, s’inspirant de plus de la moitié des œuvres de Ptolémée, dont ils copiaient le texte. »
Dreyer nous dit :
« Bien que l’Europe ait une dette de gratitude envers les Arabes pour avoir entretenu la flamme de la science pendant de nombreux siècles et pour avoir fait des observations, dont certaines sont encore précieuses, on ne peut nier qu’ils ont laissé l’astronomie telle qu’ils l’ont trouvée. »
Et:
« Lorsque les Européens recommencèrent à s’occuper des sciences, ils trouvèrent l’astronomie pratiquement dans le même état où Ptolémée l’avait laissée au 2e siècle.
Ces points de vue sont communs à la grande majorité des écrits sur l’histoire de l’astronomie. En fait, bien souvent, l’astronomie islamique est complètement occultée. JP Verdet, par exemple, dans une Histoire de l’Astronomie, saute de Ptolémée à Copernic, en sautant 1400 ans. Et Neugebauer aussi dans son Astronomie et Histoire. »
Ces points de vue, cependant, sont totalement contredits par l’histoire, comme le montre le schéma suivant.
1. Reconsidérer l’histoire de l’astronomie
Quand on lit les historiens occidentaux traitant de la science musulmane, ils font penser à ces gens formés dans les écoles arabes du Caire, de Damas et de Bagdad, qui, rencontrant ou traitant de quelque chose d’occidental, ou d’une percée occidentale, affirment qu’il s’agissait d’abord d’une invention arabe ou qu’il avait des antécédents arabes. Ils pourraient même prétendre que l’électricité a été inventée par les Arabes, tout comme le Concorde et même Internet. En fait, cet auteur avait un de ces professeurs qui affirmait que Shakespeare était en fait Cheikh al Zobeir.
Or, dans le traitement de l’Islam, de la foi et de la culture, il est très difficile pour les auteurs formés à la culture classique de s’écarter de ce qu’ils ont acquis au cours d’une telle formation. Leurs connaissances de base deviennent pour eux le point de départ, et tout devient associé à la Grèce : soit « grec, soit néo-grec ». Par conséquent, l’étranger, généralement l’islamique, avec lequel ils se trouvent obligés de lutter par nécessité (car ils ne peuvent pas le rejeter comme le font les historiens plus directs), doit être expliqué par rapport au concept/manifestation/percée/théorie grecque ou néo-grecque ou édulcorée et autres. C’est ce qui explique dans une large mesure pourquoi la Grèce est considérée comme la source de tout et pourquoi, à quelques exceptions près, les travaux des chercheurs occidentaux sur la civilisation islamique sont une horrible succession de néo-grec ceci, néo-grec cela, que même La Mecque semble parfois être une ville néo-grecque. Cependant, il ne s’agit pas d’une explication unique, comme l’indiquent de nombreuses parties de cet ouvrage, notamment le fait qu’il est extrêmement difficile pour les chercheurs occidentaux (tout comme pour le reste de la société) de mettre de côté les préjugés hérités d’un enseignement biaisé et des médias, ainsi que de l’héritage de quatorze siècles de conflit entre l’Islam et le Christianisme. L’aversion omniprésente à l’égard de l’Islam doit se manifester d’une manière ou d’une autre, et l’érudition n’est pas différente des autres formes d’expression ; sauf que l’aversion porte un vernis savant, renforcé par des notes de bas de page ou de fin ici et là, même si la plupart d’entre elles n’ont en réalité que peu de pertinence par rapport à ce qui est affirmé. Très souvent, surtout parmi les savants d’aujourd’hui, qui dans leur grande majorité sont plus que boiteux, lorsqu’on leur demande de contribuer à un article dans une encyclopédie ou un livre moderne sur l’Islam, leur astuce pour dissimuler leur boiterie est de noyer le lecteur dans une infinité de détails et des complexités, une masse de choses insignifiantes qui vous brisent le cerveau, qui vous font abandonner, accepter leur revendication, quelle qu’elle soit, et jeter cette foutue chose aussi loin que possible, et faire le vœu de ne plus jamais lire. D’autres « érudits » modernes de l’Islam, avec leurs limites, lorsque l’élément islamique s’immisce dans leur tâche, font ce qui est généralement fait : répéter simplement ce que n’importe quelle « autorité » précédente a affirmé, aussi déformée soit-elle, et passer à autre chose. C’est le genre d’environnement (à de très rares exceptions près) qui entoure l’étude du rôle islamique dans l’essor de la science et de la civilisation modernes, tout comme d’ailleurs d’autres sujets islamiques. Toutefois, si l’on aborde les sujets liés à l’Islam en dehors de ce contexte/environnement, le tableau qui se dégage est totalement différent. Cela se voit clairement dans l’histoire de l’astronomie. En considérant ce sujet hors des sentiers battus et déformés qui ont entaché son étude, deux conclusions deviennent évidentes :
Premièrement, c’est la foi de l’Islam, plutôt que celle de la Grèce, qui était à l’origine des réalisations astronomiques islamiques (la science grecque n’était qu’un outil aux côtés de la science hindoue et chinoise).
Deuxièmement, plutôt que d’être une réplique de l’astronomie grecque, l’astronomie musulmane n’a pas seulement réfuté son homologue grecque, elle nous a également amené aux limites de l’astronomie moderne telle que nous l’avons aujourd’hui.
Ces deux questions sont abordées tour à tour.
A. Le rôle de l’Islam dans l’essor de l’astronomie.
Dans l’un de leurs derniers ouvrages, Hoskin et Gingerich proposent une bonne section d’introduction à l’astronomie islamique. Ils montrent comment l’observation de la foi a confronté les musulmans à des problèmes qu’ils devaient résoudre, ce qui les a amenés à développer des aspects de l’astronomie mathématique pour résoudre ces problèmes. Ce qui suit est un bref aperçu de cette section qui, sans aucun doute, même si elle utilise dans la plus grande mesure les mots et les lignes mêmes des deux auteurs, ne transmettra pas l’argument avec autant d’érudition que l’ont fait Hoskin et Gingerich. « Les pratiques religieuses de l’Islam ont généré trois défis spécifiques auxquels les astronomes mathématiciens ont tenté de trouver des solutions. Le premier est né du calendrier lunaire, chaque mois commençant avec la nouvelle lune, lorsque le croissant lunaire a été aperçu pour la première fois dans le ciel du soir. Si le croissant était vu, cela signifierait le début du mois, comme le mois de jeûne (Ramadhan), ou la fin de celui-ci. Le problème reste que le ciel n’est pas toujours clair, et même s’il l’était, les observateurs situés à différents endroits pourraient ne pas voir la lune. Pour résoudre ce problème, les astronomes musulmans ont suivi les critères trouvés dans les sources indiennes, ainsi que ceux trouvés chez Ptolémée, qui, bien qu’utiles, n’ont pas réussi à fournir des réponses adéquates. Les astronomes musulmans ont dû compiler des tableaux sophistiqués pour faciliter les calculs, conduisant à la production d’almanachs contenant des informations sur la possibilité d’observations au début de chaque mois. La deuxième exigence religieuse qui concernait l’astronomie concernait les heures de prière, dont le nombre était de cinq : coucher du soleil, tombée de la nuit, lever du jour, midi et après-midi. Le moment de ces deux dernières, plus celui d’une prière volontaire en milieu de matinée, correspond aux fins des troisième, sixième et neuvième des heures (variables) du jour. Trouver l’heure exacte du jour à partir de l’altitude du soleil ou l’heure de la nuit à partir de l’altitude des étoiles brillantes a été résolu à Bagdad au 9ème siècle. Dès ce siècle, l’équivalent médiéval des six fonctions trigonométriques modernes avait été reconnu, alors que Ptolémée fonctionnait avec une seule corde. Les astronomes islamiques ont découvert des identités trigonométriques de base qui ont grandement simplifié les calculs impliquant des triangles sur la sphère céleste. L’institution du muwaqqit, le chronométreur, dans les mosquées, a donné aux astronomes compétents une base institutionnelle centrale à partir de laquelle opérer, et a conduit à une augmentation rapide de la quantité et de la qualité des écrits astronomiques. Le troisième défi concerne l’orientation des prières et des mosquées vers La Mecque depuis n’importe quel endroit du monde. Les astronomes musulmans ont appliqué leur esprit pour résoudre le problème de la détermination mathématique de la qibla (orientation sacrée) à l’aide des données géographiques disponibles. Des formules de trigonométrie sphérique ont été développées et des tableaux calculés à partir d’elles. Une réalisation remarquable (d’Al-Biruni), datant peut-être du 11ème siècle, fut le développement de grilles cartographiques pour les cartes du monde centrées sur La Mecque, à partir desquelles on pouvait lire directement la qibla et la distance jusqu’à La Mecque. »